Littérature
Trois femmes, trois générations (Le passage obligé)
Que dire de neuf à propos de Michel Tremblay, alors que paraît le quatrième et dernier tome de La diaspora des Desrosiers, intitulé Le passage obligé ? Rien, on y retrouve l'écrivain qu'on aime, conteur hors pair, comme un vieil ami avec lequel il est facile et naturel de reprendre la conversation interrompue, un an plus tôt. Le passage protégé est pourtant l'épisode le plus sombre de la saga de cette famille, écartelée entre Saskatchewan, Ottawa et Montréal. Le pittoresque et le cocasse s'effacent devant la gravité du propos. Enfin presque, puisqu'enchâssés au sein du roman, trois courts contes fantastiques égaient et enjolivent un récit par ailleurs bien noir. Le livre est avant tout le portrait de trois femmes. Trois générations. Maria, l'adolescente privée de mère, qui doit assumer le rôle de maîtresse de maison au détriment de ses études ; Nana, la mère privée de ses enfants, irrésolue, rebelle, en lutte contre le monde entier et surtout elle-même ; Joséphine, la grand-mère, à l'agonie douloureuse, elle qui n'a jamais fait que le bien autour d'elle. Cette fresque intime nous plonge dans le Québec de 1915, où le conservatisme et la religiosité commencent à perdre du terrain face aux idées modernes. Un beau roman, mais c'est un cliché concernant l'oeuvre de Tremblay, tout en cris et chuchotements, dans lequel chacun des personnages est à la croisée des chemins et dont le restant de sa vie dépendra d'un choix impossible à prendre.
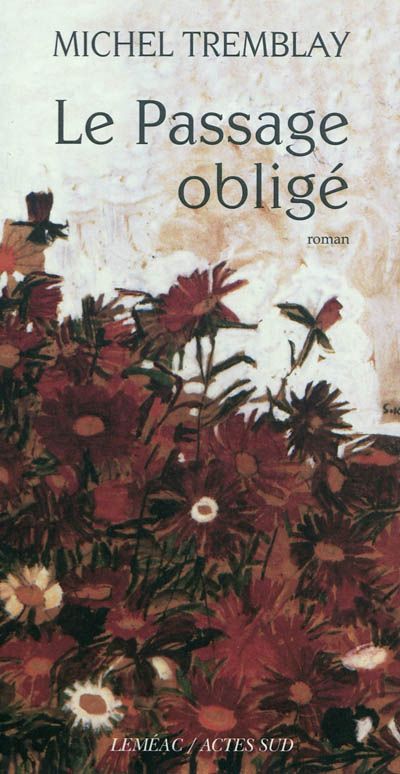
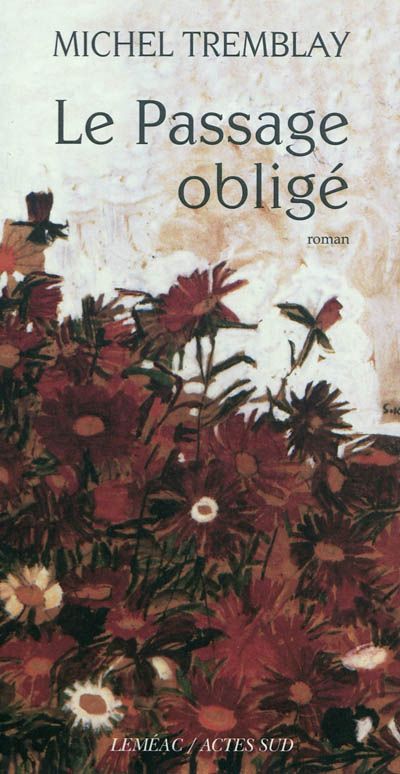
Trois hommes et des femmes (Homo Erectus)
Tonino Benacquista a un véritable don pour
embarquer d'emblée ses lecteurs dans une histoire originale et riche de
promesses. Il n'est pas le seul, van Cauwelaert et Bruckner, par
exemple, ont aussi ce talent des commencements, mais il leur arrive,
plus souvent qu'à leur tour, de ne savoir que faire d'heureuses prémices
et de gâcher leur bonne idée de départ. Ce danger là, Benacquista a
déjà prouvé qu'il savait le contourner en nous entraînant vers des
horizons inattendus. Le tout, avec une fluidité qui semble facile et une
décontraction narquoise qui fait mouche. Homo Erectus commence par la
description d'une réunion secrète d'hommes solitaires, victimes d'amours
malheureuses, qui se donnent rendez-vous régulièrement pour écouter les
témoignages de leurs congénères. Une sorte de mélange entre les séances
des alcooliques anonymes et la franc-maçonnerie, pour faire court. Bien
entendu, le romancier sait qu'il ne tiendra pas 300 pages en égrenant
une multitude de récits de déboires sentimentaux, fussent-ils
passionnants et pittoresques. Le livre se concentre alors sur l'histoire
de trois hommes, très différents, et de leurs rapports avec la gent
féminine. Entre le serveur, qui voit arriver chez lui une squatteuse
mystérieuse, le philosophe, qui entretient une liaison avec une top
model et le poseur de fenêtres, consommateur de prostituées, Benacquista
tisse consciencieusement sa toile, ménageant ses effets, soufflant le
chaud et le froid avec un art consommé de conteur. Il sait où il va, le
bougre, et sème son chemin de petits cailloux, comme autant de
réflexions sur notre époque et sur l'éternelle question des rapports
amoureux. Le roman est de facture classique, solidement arrimé à un
scénario conçu de façon à agripper le lecteur, qui ne peut se libérer de
son emprise. Les femmes sont omniprésentes, pas toujours à leur
avantage, mais pas plus malmenées que l'autre sexe. Ce sont elles qui
ont le dernier mot, dans un dénouement d'une adresse diabolique, qui
renvoie au début du livre, comme une boucle qui se ferme. De la belle
ouvrage, une fois de plus.
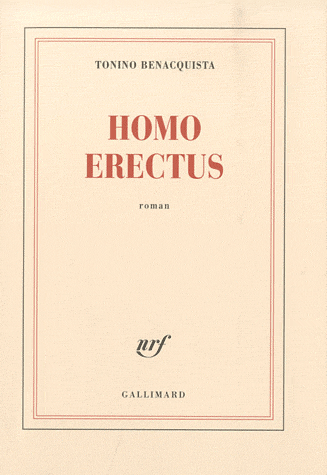
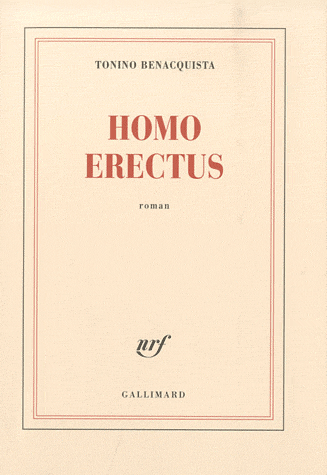
L'enfer du décor (Le destin du touriste)
A ceux qui jugeraient que l'écrivain portugais Rui Zink pousse le bouchon un peu loin dans son roman Le destin du touriste, il n'est pas inutile de préciser qu'il existe déjà des agences spécialisées dans des voyages organisés extrêmes, que ce soit en Irak ou aux abords de Tchernobyl, aux risques et périls des participants, bien entendu. Le livre est censé se passer dans un futur proche, une dystopie à la manière d'un Orwell ou Huxley, dans laquelle l'auteur affiche d'emblée la couleur : ce sera un ouvrage sarcastique, provocateur, méchant comme un pou. Dans sa première partie, nous suivons Greg, touriste individuel, qui semble se démarquer de ses congénères venus visiter en "troupeau" un pays en pleine guerre civile et se donner le frisson suprême, une bonne dose d'adrénaline à côtoyer la misère et la mort, dans un confort tout relatif. Greg, lui, cynique intégral et personnage suicidaire, ne semble poursuivre qu'un seul but, lequel se révèle assez vite dans le livre (laissons cependant planer le mystère). Dans un deuxième temps, le roman devient haché, divisé en de courts chapitres, et Zink, en révélant l'enfer du décor, qui est un peu différent de ce que l'on imaginait, se fait sociologue, dévoilant à mo(r)ts couverts où l'action se passe réellement (laissons toujours planer le mystère). Ce changement de focale est moins convaincant dans le sens où l'auteur force un peu le trait, abandonnant peu à peu le conte satirique pour une réflexion moraliste sur le devenir de nos civilisations. L'impression finale reste mitigée, celle d'avoir lu un ouvrage hybride, habile pour créer un malaise certain, manipulateur et un peu bâclé, mais dont le comique de répétition et l'ironie cinglante laissent cependant une trace durable. Il faut bien reconnaître à Rui Zink un vrai talent pour souffler le show et l'effroi.


Une armée de pantins en déroute (Les greffiers du diable)
Les greffiers du diable, de Vilma Fuentes,
commence de façon on ne peut plus factuelle. Son personnage principal :
un journaliste mexicain d'investigation, obligé de quitter son pays, du
moins pour un temps, car menacé de mort. Nous voici embarqués dans un
roman politique et critique, dont l'acidité est le carburant essentiel.
Passé le premier tiers du livre, notre héros se retrouve à Paris et va
fréquenter la petite communauté mexicaine en exil, qui gravite autour de
la figure très charismatique et énigmatique de l'ancien président de la
république, un certain Icaro Guzman. A partir de là, le roman délaisse
le journaliste et passe d'un personnage à un autre, tantôt dans un style
très réaliste, tantôt dans une évocation trouble et flottante, qui
flirte avec le fantastique. C'est une armée de marionnettes en déroute
que nous décrit Vilma Fuentes, des pantins exsangues dont la seule
raison d'exister est de croiser le chemin de Guzman. Le roman alterne le
bon, des dialogues acérés et cinglants, et l'ennuyeux, de longues pages
dont on se demande si elles n'appartiennent pas à des existences rêvées
plutôt que vécues. Ce flou artistique, volontairement entretenu,
brouille un peu la perception du lecteur, qui, de temps à autre, se perd
dans ce labyrinthe narratif, aux qualités littéraires avérées mais
parfois stériles.
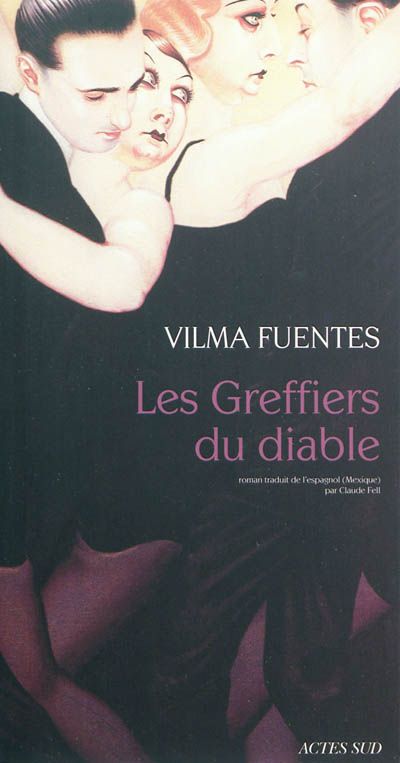
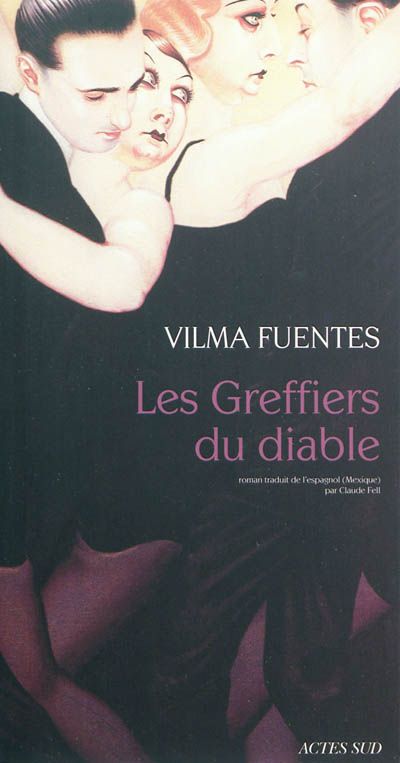
Fables pour une époque cynique (Pain et tempête)
Vous en connaissez beaucoup, vous, des
livres dont vous devez interrompre la lecture à intervalles réguliers,
pour cause de fou rire incontrôlé ? Pain et tempête de Stefano Benni est
de cette race là et ce n'est pas sa seule qualité. De quoi s'agit-il ?
De la lutte d'un carré d'irréductibles d'un petit village du sud de
l'Italie, le plus souvent accoudés au comptoir du mythique Bar Sport,
contre des promoteurs immobiliers cyniques et une municipalité cupide.
De cette trame linéaire, Benni s'échappe sans cesse, parce que son goût
n'est pas pour les autoroutes rectilignes mais bien pour les sentiers de
traverse. Alors, l'auteur digresse, et nous offre une vingtaine
d'histoires annexes, comme autant de petites nouvelles aux allures de
contes populaires. Et ceci, en variant les styles, du grotesque
rabelaisien à la sagesse de Montaigne, quand ce n'est pas une atmosphère
fantastique qui vient nimber ces récits le plus souvent hilarants. Dans
Pain et tempête, on rencontre beaucoup d'animaux qui parlent et qui
résolvent les problèmes des humains. Ainsi, ces brebis qui viennent en
aide à un berger esseulé en le connectant à Sheepskype sur internet. Ou
bien, "le chien le plus intelligent du monde", capable de dénicher
n'importe quel gibier après avoir vu son image dans un dictionnaire.
Facétieuses, incongrues, sarcastiques, saugrenues, pétillantes : tous
les qualificatifs conviennent pour ces fables délirantes et loufoques.
Gnomes surgis de la forêt, sorcières maléfiques, fantômes mélancoliques :
ils jouent tous un rôle, jusqu'à Belzébuth, en personne, lancé dans une
partie de ping-pong échevelé contre un simple mortel. Mais à quoi bon
s'échiner à tenter de décrire Pain et tempête, c'est un roman qui se
déguste le sourire en bandoulière et les yeux écarquillés devant
l'imagination de l'auteur. Le spectre du grand Edgar Poe, lui-même, fait
une apparition à la fin du livre et résume bien l'affaire : "Peur et
gaieté, parfois, sont enfermées dans la même boîte, comme un carillon
qui posséderaient deux sonneries." Bon sang, mais c'est bien sûr, à
force de se gondoler, on en oublierait presque que Stefano Benni, à la
façon des meilleurs fabulistes, nous décrit une société privée de
repères et de valeurs, toute entière livrée aux spéculateurs et aux
zélateurs de la consommation de masse. Stefano Benni est avant tout un
moraliste qui ne craint pas de caricaturer pour mieux dénoncer. Et nous,
on dit : "Grazie mille."
Un coup de chapeau à la traductrice, Marguerite Pozzoli, qui a fait des prodiges pour restituer la langue haute en couleurs de l'auteur.

Un coup de chapeau à la traductrice, Marguerite Pozzoli, qui a fait des prodiges pour restituer la langue haute en couleurs de l'auteur.
