Récolte de vieux films (Avril/1)

Les larmes d'une femme (Nyonin aishu, Mikio Naruse, 1937)
Après avoir consenti à un mariage arrangé, Hiroko se retrouve au sein d'une famille qui l'utilise comme véritable bonne à tout faire, son mari la considérant comme un objet de décoration. Ce portrait de femme, qui doit choisir entre l'asservissement et la liberté, préfigure les figures féminines des grands films de Naruse des années 50. Les larmes d'une femme est une oeuvre simple, d'une grande maîtrise technique, qui est déjà un manifeste pour l'émancipation de la femme dans le Japon conservateur de la fin des années 30. Joli film.
La fille sur la balançoire (The girl in the red velvet swing, Richard Fleischer, 1955)
Toute la flamboyance du technicolor dans ce drame écarlate tiré d'une célèbre affaire du début du XXe siècle (que Chabrol reprit dans La fille coupée en deux). Censure oblige, Fleischer ne put que suggérer la passion perverse entre le vieux Ray Milland et la jeune et superbe Joan Collins. Farley Granger y trouve pour sa part l'un de ses meilleurs rôles. Un très bon film, qui aurait pu accéder au rang de chef d'oeuvre si le cinéaste avait eu l'opportunité d'accentuer le malaise de cette histoire malsaine. La dernière scène, qui justifie le titre du film, est en tous cas inoubliable.
Indiscret (Indiscreet, Stanley Donen, 1958)
Une comédie de moeurs sophistiquée, telle qu'elle se pratiquait avec plus de régularité dans le cinéma des années 30. D'où, peut-être, une impression de superficialité, derrière le marivaudage. On y décèle cependant une once de pessimisme dans le rapport amoureux, comme préfigurant le sujet de Voyage à deux, du même Donen, 9 ans plus tard. Pour la scintillance des dialogues, on ne boudera cependant pas son plaisir. Avec une Ingrid Bergman rayonnante et un Grant Carysmatique.
Gumshoe (Stephen Frears, 1971)
Un premier long-métrage sous le signe du pastiche/hommage au film noir. L'intrigue est plus embrouillée que dans un Chandler, mais il y a des répliques qui tuent, une plongée intéressante dans le Liverpool des classes modestes et un Albert Finney épatant en Humphrey Bogart du pauvre. Après cet échec public, Frears se consacrera à la télé avant de trouver la notoriété au cinéma avec The Hit, en 1984.

Le filet (La red, Emilio Fernandez, 1953)
Une hutte sur la côte mexicaine. Une femme et deux hommes, recherchés par la police. Le filet n'est pas pour rien le film le plus emblématique de l'oeuvre d'Emilio Fernandez. Le récit est épuré, les dialogues se limitent à quelques phrases, tout n'est que huis-clos à ciel ouvert, avec l'océan pour témoin. Les qualités plastiques du Filet sont évidentes, son symbolisme érotique parfois embarrassant, mais qu'importe. C'est le désir animal qui fait avancer cette histoire, aux accents primitifs, symbolisé par Rosanna Podesta, bombe sexuelle à l'état pur. 25 ans plus tard, Fernandez tournera un remake en couleurs sous le titre explicite d'Erotica. Très inférieur à l'original.
Cadres en crise supérieure (The Company Men)
Tiens, un film américain qui montre les effets de
la crise économique, la politique de licenciements massifs des grands
groupes, le cynisme des patrons aux poches bourrées de stock options ...
Bon, on se calme, The Company Men n'est pas précisément une oeuvre
d'extrême gauche et son discours est un peu raboté par les conventions
hollywoodiennes, mais quand même... Le personnage d'ouvrier, joué par
Kevin Costner (welcome back !) balance quelques vérités de temps à autre
qu'on a peu l'habitude d'entendre dans un cinéma aussi formaté. C'est
un honnête film sur le chômage, certes celui de cadres supérieurs qui ne
feront pas pleurer dans les chaumières, qui est d'une sobriété
exemplaire, sans apitoiement excessif et dont l'humour occasionnel est
le bienvenu. Bien écrit, le film pâtit cependant d'une mise en scène
d'une grande platitude qui ramollit quelque peu l'intérêt. On ne
s'ennuie pas pour autant grâce à une interprétation aux petits oignons.
Ben Affleck, Chris Cooper et un Tommy Lee Jones aux taquets hissent The
Company Men au-dessus du commun de la production américaine. Pas à la
catégorie cadre supérieur, c'est entendu, mais largement plus haut que
le minimum syndical.


Trois femmes, trois générations (Le passage obligé)
Que dire de neuf à propos de Michel Tremblay, alors que paraît le quatrième et dernier tome de La diaspora des Desrosiers, intitulé Le passage obligé ? Rien, on y retrouve l'écrivain qu'on aime, conteur hors pair, comme un vieil ami avec lequel il est facile et naturel de reprendre la conversation interrompue, un an plus tôt. Le passage protégé est pourtant l'épisode le plus sombre de la saga de cette famille, écartelée entre Saskatchewan, Ottawa et Montréal. Le pittoresque et le cocasse s'effacent devant la gravité du propos. Enfin presque, puisqu'enchâssés au sein du roman, trois courts contes fantastiques égaient et enjolivent un récit par ailleurs bien noir. Le livre est avant tout le portrait de trois femmes. Trois générations. Maria, l'adolescente privée de mère, qui doit assumer le rôle de maîtresse de maison au détriment de ses études ; Nana, la mère privée de ses enfants, irrésolue, rebelle, en lutte contre le monde entier et surtout elle-même ; Joséphine, la grand-mère, à l'agonie douloureuse, elle qui n'a jamais fait que le bien autour d'elle. Cette fresque intime nous plonge dans le Québec de 1915, où le conservatisme et la religiosité commencent à perdre du terrain face aux idées modernes. Un beau roman, mais c'est un cliché concernant l'oeuvre de Tremblay, tout en cris et chuchotements, dans lequel chacun des personnages est à la croisée des chemins et dont le restant de sa vie dépendra d'un choix impossible à prendre.
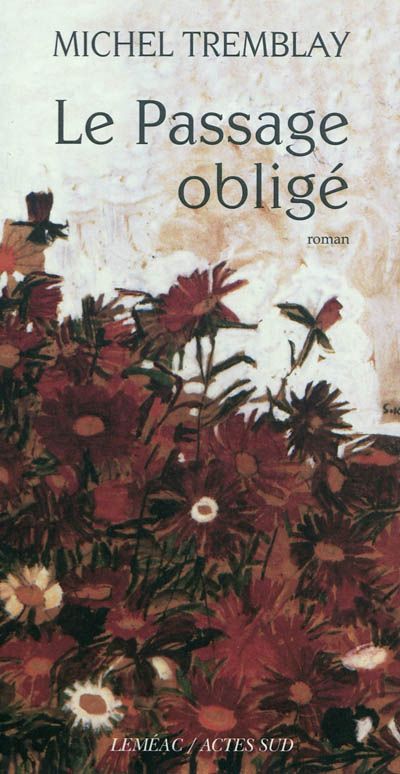
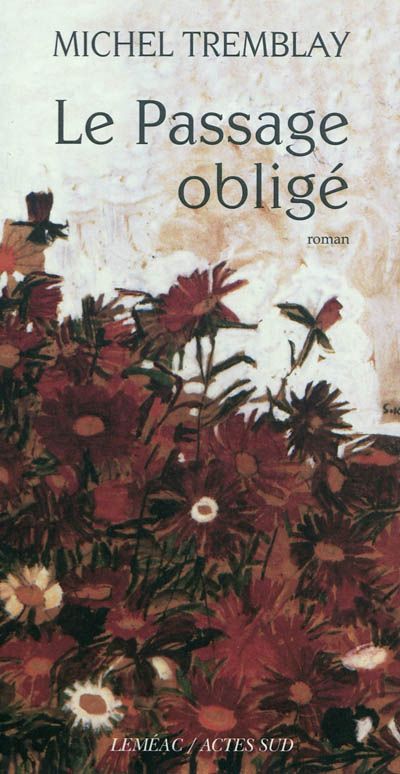
Surineur (Grèce)
Macherovgaltis (Yannis Economides, 2010)
Troisième long-métrage de Yannis Economides, un réalisateur qui marche à l'économie. Peu ou pas de dialogues, d'intrigue et de personnages dans ce film en noir et blanc, dont la trame est peu ou prou celle du Facteur sonne toujours du fois. Banlieue grisâtre d'Athènes, langage ordurier, rapports de force. Avec un sens du rythme qui ferait passer Angelopoulos pour Tarantino. Minimal et fastidieux.

Note : 4/10
Troisième long-métrage de Yannis Economides, un réalisateur qui marche à l'économie. Peu ou pas de dialogues, d'intrigue et de personnages dans ce film en noir et blanc, dont la trame est peu ou prou celle du Facteur sonne toujours du fois. Banlieue grisâtre d'Athènes, langage ordurier, rapports de force. Avec un sens du rythme qui ferait passer Angelopoulos pour Tarantino. Minimal et fastidieux.

Note : 4/10
Un charme frelaté (Je n'ai rien oublié)
Small World, le roman du suisse Martin Suter, est
un thriller familial où un Alzheimer fait remonter à la surface des
secrets enfouis depuis longtemps. Le livre est gonflé, cinglant et
destructeur. Son adaptation par Bruno Chiche, dans Je n'ai rien oublié,
est aseptisée, les conflits y sont tempérés par le passage du temps et
le suspense y est vite éventé. Malgré cela, il y a une vraie atmosphère
dans le film, une parfum de chic bourgeois moisi par les hypocrisies et
les mensonges nécessaires pour tenir son rang. Les deux personnages en
marge, celui de Depardieu (excellent) et d'Alexandra Maria Lara
(superbe), sont les plus choyés par la réalisation, les plus étoffés,
quoique gardant une part de leur mystère. Leur alchimie incongrue fait
en tous cas tenir le film debout. Le reste de l'interprétation est
remarquable, d'autant plus que les rôles sont assez convenus : Arestrup,
Fabian, Baye ..., c'est du solide. Alors oui, on l'aurait voulu un peu
plus méchant et moins ouaté, ce film. Tel quel, avec ses langueurs et
son ambiance suranné, il a le charme frelaté des photos couleur sépia.

