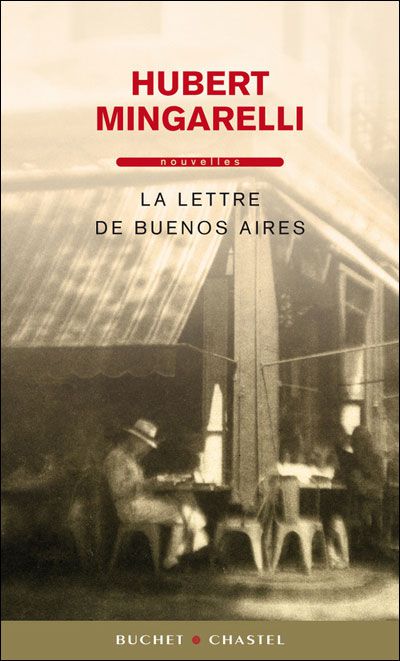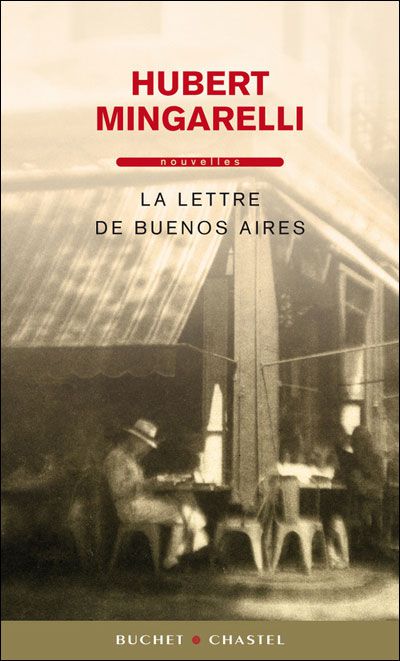La mélancolie solitaire de l'homme (La lettre de Buenos Aires)
Les premières nouvelles de La lettre de Buenos
Aires sont courtes. Très. Brèves histoires qui n'en sont pas vraiment.
Pourtant, insensiblement, Hubert Mingarelli a installé un climat, créé
une atmosphère. Et les derniers récits ne prennent que plus d'ampleur,
sur davantage de pages, comme s'il avait fallu ce préambule, un
conditionnement pour apprécier à sa juste valeur la qualité de
l'écriture concise de l'auteur, capable de transcender de "petites"
fictions en réflexion sur la profonde solitude de l'homme en ce bas
monde. Les personnages de Mingarelli sont en marge, volontairement ou
pas, fragiles et errants. Leur boussole est cassée, mais ils avancent.
Ou essaient. L'écrivain excelle pour décrire la beauté et l'hostilité
des éléments. En forêt, sur une rivière, en pleine mer, la nature n'est
pas tendre. Mais elle ne fait que jouer son rôle, pourquoi serait-elle
bienveillante ? La faim, la peur, la fatigue : les hommes des nouvelles
de Mingarelli (les femmes n'y ont guère de place) survivent tant bien
que mal. Oui, c'est bien de mélancolie qu'il s'agit, dans ces fragments
d'existence dispersés par le vent. Jusqu'au dernier récit, qui clôt
magistralement l'ouvrage, véritable camaïeu de gris, dans une obscurité
profonde. La lettre de Buenos Aires est un livre désespérément humain.
Désespéré, et surtout, humain.